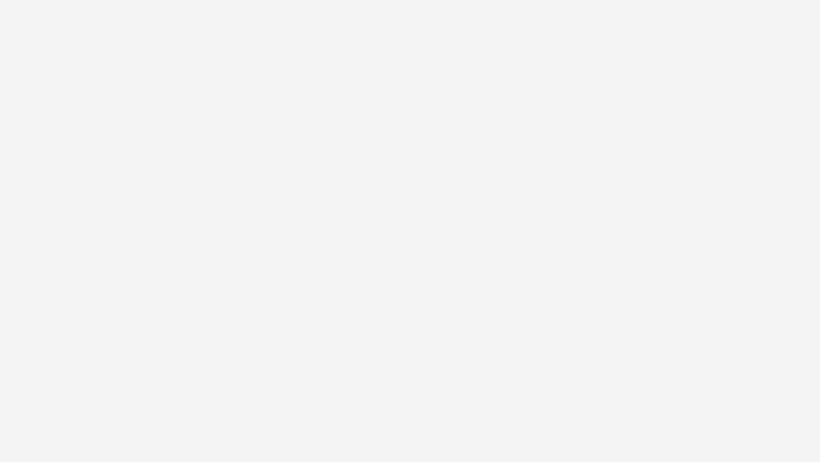ANTANANARIVO – La scène a quelque chose de surréaliste. Un président qui gouverne son pays depuis l’étranger, une Assemblée nationale dissoute par décret, une armée qui se divise entre loyalistes et putschistes. Ce lundi 14 octobre, Madagascar a basculé dans une crise politique d’une ampleur historique, tandis qu’Andry Rajoelina, exfiltré vers La Réunion par les soins de l’armée française, tentait depuis l’étranger de reprendre la main sur un pouvoir qui lui échappe.
Dans la nuit, le président a signé un décret de dissolution de l’Assemblée nationale, invoquant l’article 60 de la Constitution. Une décision radicale, prise à des milliers de kilomètres de la capitale, alors que la Grande Île connaît sa plus grave secousse politique depuis la chute de Marc Ravalomanana.
L’étrange exfiltration
Le récit officiel – une « mission à l’étranger pour assurer sa sécurité » – cache une réalité plus trouble. Selon RFI, l’exfiltration de Rajoelina aurait été orchestrée par la France dans le cadre d’un accord direct avec Emmanuel Macron. Le président malgache aurait transité par La Réunion avant de gagner une destination inconnue.
LIRE AUSSI : https://journaldeconakry.com/madagascar-le-president-andry-rajoelina-exfiltre-vers-letranger/
Pendant ce temps, à Antananarivo, la situation échappait à tout contrôle. Un groupe de militaires a tenté de prendre le contrôle des médias publics, dans ce que la présidence a qualifié d’« acte grave portant atteinte à l’ordre constitutionnel ». Le chef d’état-major des armées, le général Démosthène Pikulas, a dû intervenir personnellement pour « rétablir la situation ».
Le peuple et l’armée en mouvement
La veille, sur la place du 13 Mai, des milliers de Malgaches s’étaient rassemblés pour réclamer le départ de Rajoelina. Une mobilisation historique, portée par la Génération Z Madagascar et rejointe par d’anciens présidents et des figures de l’opposition. Plus significatif encore : des membres des forces armées avaient fait cause commune avec les manifestants.
Le colonel Mikaël Randrianirina, l’un des officiers impliqués dans la tentative de prise des médias, a nié toute intention putschiste. « L’armée a simplement répondu à l’appel du peuple malgache », a-t-il déclaré à la presse, se présentant comme un simple « officier exécutant ».
Un pouvoir en exil
Depuis son refuge extérieur, Rajoelina a tenté de reprendre l’initiative. Dans une allocution retardée de plus de deux heures, il a catégoriquement rejeté toute idée de démission, tout en reconnaissant avoir quitté le territoire national. « Je n’abandonnerai jamais Madagascar », a-t-il assuré, dénonçant un « complot préparé depuis plusieurs semaines pour attenter à sa vie ».
Sa décision de dissoudre l’Assemblée s’accompagne d’un message adressé à la jeunesse : « Place aux jeunes ». Un slogan qui sonne comme une tentative de récupération, alors que ce sont précisément les jeunes de la Génération Z qui réclament son départ dans la rue.
L’ombre de la France
L’implication française dans cette crise complique encore la donne. L’exfiltration de Rajoelina par Paris place l’ancienne puissance coloniale au cœur d’un conflit politique dont elle se défend pourtant de vouloir être actrice. La France devra maintenant naviguer entre son soutien historique à Rajoelina et la réalité d’un pays où la légitimité du pouvoir en place est ouvertement contestée.
Alors que Madagascar s’enfonce dans l’incertitude, une question demeure : comment un président peut-il gouverner un pays qu’il a fui, face à un peuple descendu dans la rue et une armée qui semble hésiter entre obéissance et rébellion ? La crise malgache vient peut-être de trouver sa réponse : le pouvoir n’est plus à Antananarivo, mais quelque part entre Paris, La Réunion et l’inconnu.